Cafephilos › Forums › Les cafés philo › le café philo à la Maison Rousseau et Littérature – GENEVE › Séance 6. La violence de la femme est-elle dans ses charmes ? A 18h30 ce vendredi 01.03.2024 à la Maison Rousseau Littérature.
- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 3 mois.
-
AuteurMessages
-
25 février 2024 à 8h31 #7216Le café philo à la Maison Rousseau Littérature se tient tous les premiers vendredi du mois à 18h30
> vendredi 01 mars; 05 avril; 03 mai 2024, etc.
Thématique de la séance 6, ce vendredi 01.03.2024 à 18h30
Extrait de texte du jour proposé :
« Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l’homme au lieu de le provoquer ; sa violence à elle est dans ses charmes ; c’est par eux qu’elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user. L’art le plus sûr d’animer cette force est de la rendre nécessaire par la résistance. Alors l’amour-propre se joint au désir, et l’un triomphe de la victoire que l’autre lui fait remporter. De là naissent l’attaque et la défense, l’audace d’un sexe et la timidité de l’autre, enfin la modestie et la honte dont la nature arma le faible pour asservir le fort. »
J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre V, p.395 (du pdf ici de philolabo-Grenoble)Proposition pour le débat :
1° En deux phrases, précisons comment nous comprenons l’extrait de texte proposé.
2° Suggérons une question pour notre débat.
3° Débattons à partir d’une question ou du résumé de l’ensemble d’entre elles.Ps : Nous nous inspirons d’une citation de Rousseau pour provoquer le débat, non pour en faire leçon, ni pour l’enseigner. Chacun est le bienvenu, avec ou sans connaissance de l’auteur.
Règle du débat :
– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu ;
– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins ;
– Il n’y a pas de question taboue, ni d’attaque d’ad hominem ou ad personam.Quelques consignes :
– De sorte à encourager une circulation de la parole, on privilégie des interventions courtes sur un aspect de la question, et on avance progressivement au fur et à mesure des interventions ;
– De façon à limiter les risques de dispersion du sujet, qui sont inévitables, on essaie de relier son intervention à ce qui a été dit précédemment ;
– De la modération : chaque participant est le bienvenu pour tenter de problématiser une dispute, pour résumer (synthétiser) où nous en sommes dans le débat, pour soulever une contradiction passée inaperçue ;De la conclusion.
Elle peut être l’objet d’un exercice particulier :
– On peut tenter une petite synthèse d’un aspect du débat.
– On peut dire ce qui nous a le plus interpellé, ce que l’on retient.
– On peut se référer à un auteur (dont Rousseau, mais pas seulement) et évoquer brièvement la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.
– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat et faire des propositions pour en améliorer les conditions (tout en veillant à soutenir une liberté et une égalité d’expression que l’on souhaite transcender par une exigence de la pensée mise en pratique par chacun).Lieu : Maison Rousseau et Littérature (MRL);
Grand-Rue 40. 1204 GENEVE——————–
Des ressources en lien à notre sujet du jour
– Livre audio : Emile ou de l’éducation. Livre V. Cliquer ici.
– Eduquer les filles – Martin Rueff. Une conférence au Bénin, 2019
– Rousseau et la différence sexuelle – A. Grosrichard, P. Hochart, M. Rueff
– Gabrielle Radica – Lecture philosophique de La nouvelle Héloïse de Rousseau. Cliquer ici. Cours conférence 2021. Durée : 1h05————————-
Lien vers le compte rendu du débat précédant, ici.————————–
Origine du projet de ce café philo : quel contrat social pour le 21ème siècle ?La question du contrat social pour le 21ème siècle est la thématique du concours international et interdisciplinaire lancé par la Maison Rousseau et Littérature en 2023 (lien ici). Nous la reprenons à notre compte pour ce projet d’animation d’un café philo à la MRL.
Nous interrogerons des propositions provenant de la diversité de l’oeuvre de Jean-Jacques (mais pas uniquement), et tenterons de les questionner à la lumière de nos savoirs d’aujourd’hui et à la lumière des philosophes qui ont votre préférence (à chacun des participants). Nous ouvrons le débat et nous nous exposons aux défis de la diversité des publics et de la transversalité des savoirs.————————-
René Guichardan, café philo d’Annemasse.
> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.
– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.
– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.
> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.
– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique
– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.
> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)31 mars 2024 à 20h12 #7295Compte-rendu de notre café philo
Extrait de texte proposé :
« Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l’homme au lieu de le provoquer ; sa violence à elle est dans ses charmes ; c’est par eux qu’elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user. L’art le plus sûr d’animer cette force est de la rendre nécessaire par la résistance. Alors l’amour-propre se joint au désir, et l’un triomphe de la victoire que l’autre lui fait remporter. De là naissent l’attaque et la défense, l’audace d’un sexe et la timidité de l’autre, enfin la modestie et la honte dont la nature arma le faible pour asservir le fort. »
J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre V, p.395 (du Pdf ici de philolabo-Grenoble)Nous étions 7 personnes à ce débat. Deux questions ont été posées essentiellement, elles ont ouvert sur un troisième questionnement. Ci-dessous, les quelques questions qui ont structuré notre échange :
1° La violence de la femme est-elle dans ses charmes ?
Pour répondre de manière informée à cette question, nous conseillons vivement aux lecteurs d’écouter des spécialistes de l’interprétation de l’oeuvre de Rousseau :
– Eduquer les filles – Martin Rueff. Une conférence au Bénin, 2019
– Rousseau et la différence sexuelle – A. Grosrichard, P. Hochart, M. RueffDe notre côté, nous avons pris comme référence les quelques lignes du livre V d’Émile ci-dessous, que nous accompagnons de notre interprétation :
« Sophie doit être femme comme Émile est homme, c’est-à-dire avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe pour remplir sa place dans l’ordre physique et moral(…)
En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme : elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés ; (…) et, sous quelques rapports qu’on les considère, ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins. »Autrement dit, du point de vue de Rousseau, et par rapport aux textes religieux (pour prendre une référence patriarcale) : ni la femme ne vient de l’homme, ni l’homme de la femme. En fait, Rousseau ne remonte pas jusqu’à la question métaphysique des origines. C’est le temps d’une préhistoire fictionnelle et anthropologique de la nature qui l’intéresse. De ce point de vue, et selon la nature qu’il envisage, l’homme et la femme sont égaux. Leurs différences n’instituent ainsi aucune hiérarchie, la nature n’accorde aucune prérogative de droit ni sur l’un ni sur l’autre.
Poursuivons notre lecture :« En tout ce qui tient au sexe, la femme et l’homme ont partout des rapports et partout des différences : la difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l’un et de l’autre ce qui est du sexe et ce qui n’en est pas. (…); la seule chose que nous savons avec certitude est que tout ce qu’ils ont de commun est de l’espèce, et que tout ce qu’ils ont de différent est du sexe. Sous ce double point de vue, nous trouvons entre eux tant de rapports et tant d’oppositions, que c’est peut-être une des merveilles de la nature d’avoir pu faire deux êtres si semblables en les constituant si différemment. »
Autrement dit, l’homme et la femme sont incomparables et inassimilables l’un à l’autre. En conséquence de quoi, on ne peut s’appuyer sur les présupposés de la nature pour justifier des rapports hiérarchiques entre la femme et l’homme. La « nature » encouragerait plutôt à reconnaître des différences (et en fait la liberté), ne serait-ce que pour honorer nos facultés de discernement (une raison organisée).
« Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral ; cette conséquence est sensible, conforme à l’expérience, et montre la vanité des disputes sur la préférence ou l’égalité des sexes : comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature selon sa destination particulière, n’était pas plus parfait en cela que s’il ressemblait davantage à l’autre ! En ce qu’ils ont de commun ils sont égaux ; en ce qu’ils ont de différent ils ne sont pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d’esprit que de visage, et la perfection n’est pas susceptible de plus et de moins. »
Soulignons dans ce passage la différence morphogénétique, elle est indéniable. De fait, elle doit presque nécessairement produire des effets car, par principe, les structures agissent sur les fonctions et, selon la loi de l’adaptation darwinienne, la différence doit “influer” sur le moral. Reste à savoir comment et selon quelle variation d’un individu à un autre, d’un groupe social à un autre. Autrement dit, s’il y a une différence “psychologique” induite par la morphologie, celle-ci sera pondérée par la manière de vivre ensemble, c’est-à-dire de faire contrat (délibéré ou selon des us et coutumes). Il n’y a donc pas de hiérarchie par nature ni à l’origine ni à la suite des différences morphologiques, mais des rapports d’adaptations qui se sont élaborés au fur et à mesure que l’homme a fait société. Ainsi, selon les modalités et la diversité des groupes, tribus et cités-Etats qui se sont progressivement formés, des variations existent dans les rôles que les hommes et les femmes se sont attribués. Aujourd’hui, nous pouvons repenser à nouveaux frais, avec les savoirs dont nous disposons en anthropologie, en neurosciences, en histoire et en économie, comment peuvent être pensés nos rapports en vue qu’ils soient des sources de joie, d’épanouissement et de renouvellement (version romantique), et non des rapports d’abus et de mépris des dominants vis-à-vis les dominés (version cynique). Mais, n’en doutons pas, il y a des versions intermédiaires qui peuvent pondèrer le réalisme et l’idée de se construire un devenir désirable par le plus grand nombre, sinon par tous.
Il nous faut renverser un raisonnement. Rousseau souhaitant défendre la liberté de tous, en particulier celle des personnes vulnérables, des minorités et du singulier, la condition de réalisation de cette liberté consiste bien à postuler un rapport d’égalité entre l’homme et la femme, en dépit de leur différence et des discriminations observées partout. C’est là le génie de Rousseau et sa détermination, défendre la thèse de l’égalité entre tous les humains, il est le seul au monde à le faire à cette époque, il le fait envers et contre tous. L’égalité est la condition de la liberté, et inversement.
Dernier argument. Selon le concept de perfection (et par la suite de perfectibilité), il ne peut convenir d’extraire de la nature une thèse sur l’inégalité, pour défendre un contrat social qui, lui, soutiendrait l’égalité. En revanche, la liberté est observée partout par la diversité, par le singulier. L’imprévisible, la non-stagnation, l’ouverture, la créativité supposent une égalité entre l’homme et la femme en raison même de leur incomparabilité.
Aujourd’hui, la question de la nature fait débat, elle est au coeur d’enjeux idéologiques et politico-économiques avec son consumérisme qui instrumentalise le vivant uniquement dans une perspective de rentabilité. C’est le « quoi qu’il en coûte » macronien, qu’il fait payer non pas aux agitateurs du Léviathan des marchés financiers, mais à toute personne, à tout citoyen. C’est à l’esprit de coopération, à notre devenir social, à nos rapports d’interdépendance avec le vivant, à la biodiversité, à la qualité de l’air, de l’eau, des terres arables et des forêts… que nous faisons payer le coût de notre mode de vie, c’est-à-dire, que nous le sacrifions.La société industrielle postmoderne est traversée par des questions de genre, de techno-solutionnisme et d’homme augmenté. Derrière ces questions, qui touchent à l’identité profonde de l’être humain, s’exacerbent les rivalités de chacun contre tous, induites par les programmes informatiques et l’économie de marché. Assurément, un tel paradigme ne peut servir de base à un contrat social, il en est la négation.
Question n°2 Le charme de la femme fait-il violence à l’homme ?
Cette question est une forme de boutade, mais elle a l’avantage de questionner l’effet que la femme provoque chez l’homme, et comment ce dernier y répond. Outre le fait que sur un plan anthropologique, presque tout est possible au niveau des jeux et des rôles que la femme et l’homme se donnent, restons encore un peu avec Rousseau pour donner une interprétation se rapportant à la suite de sa citation : L’art le plus sûr d’animer cette force (celle du charme) est de la rendre nécessaire par la résistance.
Il s’agit donc d’en jouer, en conséquence de quoi, poursuit Rousseau :> Alors l’amour-propre (celui qui vient avec la société, et qui n’est pas celui de l’amour de soi, qui est premier) se joint au désir (celui de la nature), et l’un triomphe de la victoire que l’autre lui fait remporter. De là naissent l’attaque et la défense, l’audace d’un sexe (de l’homme) et la timidité de l’autre (la femme), enfin la modestie et la honte dont la nature arma le faible (la femme) pour asservir le fort (l’homme). »
Autrement dit, dans la nature, homme et femme sont égaux et incomparables, mais dans la société, l’amour-propre s’en mêlant, la femme s’est armée de “honte et de modestie” pour faire valoir ses charmes et “asservir” l’homme. En apparence, la femme (la plupart d’entre elles) s’est ainsi armée (adaptée) à la vie sociale en faisant usage de “honte et de modestie” pour jouer de l’homme qui, lui, dans un jeu de séduction, met en scène son audace. D’où il convient, si l’on veut être cohérent avec la thèse rousseauiste d’une égalité et d’une liberté premières, de savoir revenir à des rapports de liberté et d’égalité si, par quelques dérives que ce soit, le jeu ou l’amour propre conduisait à trop d’excès.
Dans la suite du débat, nous nous sommes éloignés de la dispute traditionnelle et contextuelle à notre modernité, et nous avons préféré questionner l’enjeu d’identité qui opère dans l’intimité, à long terme et dans l’intensité d’aimer.
Aimer aujourd’hui.
De fait, la question qui s’est posée est : par les bouleversements opérés dans l’intensité d’aimer, la femme et l’homme s’engagent-ils dans des rapports d’opposition, a priori nécessairement dépassables en l’état (puisqu’ils sont intrinsèquement et par nature égaux) ?
En conséquence de quoi, supposons que l’homme et la femme évitent le piège du séparatisme radical ; en effet, ce dernier postule des différences telles qu’il faudrait instaurer des barrières franches entre le masculin et le féminin. Mais de telles pratiques instituées comme règles de vie nous ramèneraient au Moyen Âge.
Nous proposons plutôt de faire un pas de côté pour se dégager des rapports de rivalité, et mieux concevoir ceux de la différence et du singulier.
Ce pas de côté requiert un dépassement de part et d’autre (un nouveau contrat) pour que l’homme et la femme poursuivent une aventure d’aimer qui dépassent à la fois leurs déterminations respectives, notamment ceux qui figent dans des rapports de rivalité. Il y a là un jeu d’équilibriste subtil et profond qui présuppose des rapports (des efforts ?) de rencontre de soi à soi-même et de soi à l’autre dans le jeu des interactions. Ce rapport de rencontre comprend le retour et/ou le repli sur soi, pour recomposer/repenser ce qui fonde notre intimité (le lieu où elle se façonne en soi). En arrière-plan de cette quête de soi, qui reste inséparable d’un rapport à l’autre, se pose la question d’une universalité conçue sur un plan anthropologique.De là, homme et femme se retrouvent de nouveau à égalité.
La question qui se pose ensuite peut consister à considérer nos déterminants anthropologiques de sorte à concevoir des types de contrat qui donnent envie à l’homme comme à la femme, de s’engager dans l’aventure d’aimer et/ou de se rencontrer.
Pour y parvenir, il semble que l’un et l’autre (et la question se pose à tout être humain) doivent tenter de faire émerger de leur perception, leur “self” dans un rapport d’autonomie. Autrement dit, il s’agit d’assumer les causes et les déterminations de ses positions (ce que je fais, je le dois à moi), sans ignorer ses interdépendances, lesquelles rappellent que, ce qui est cause de moi me vient d’autrui, de mes attachements premiers, de mon éducation, de ma classe sociale, du contexte politique, etc. Nous sommes inséparables d’un tout, et nos interactions avec ce tout, obligent et invitent à considérer ce qui s’échange via nos porosités.
En bref, il s’agit d’apprendre continuellement à nous construire librement, tout en préservant le socle rousseauiste d’une liberté inaliénable, laquelle est inconcevable sans postuler celui de l’égalité.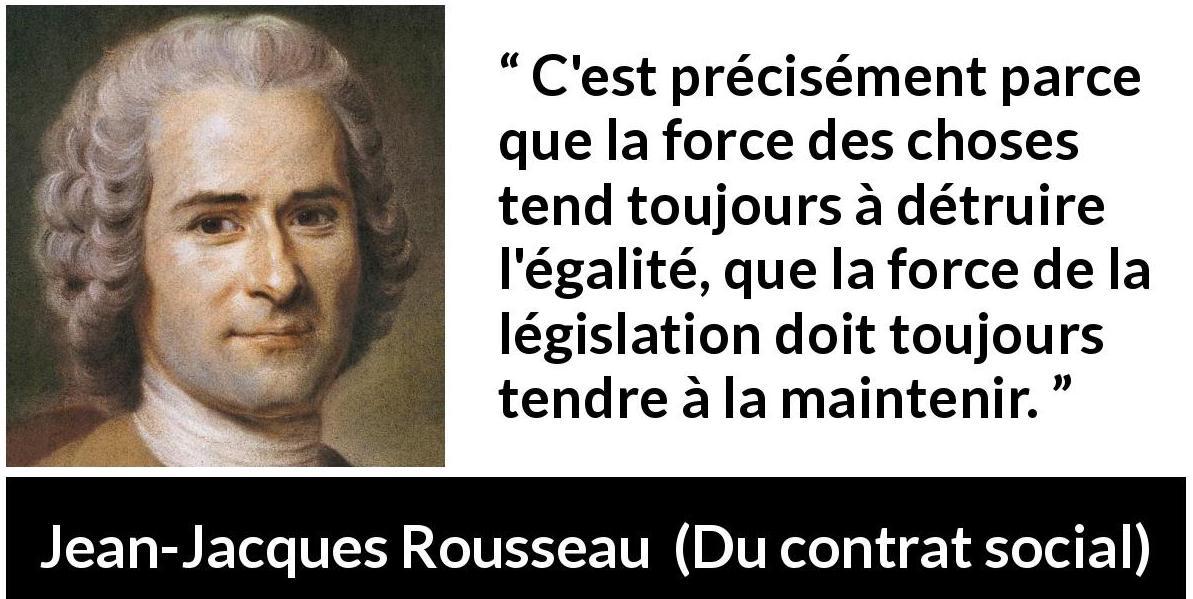
————————-
René Guichardan, café philo d’Annemasse.
> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.
– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.
– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.
> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.
– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique
– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.
> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
